L’ère du cringe assumé : quand le cool devient honteux (et vice versa)
- Harmonie de Mieville

- 24 juin
- 12 min de lecture
Dernière mise à jour : 30 juil.
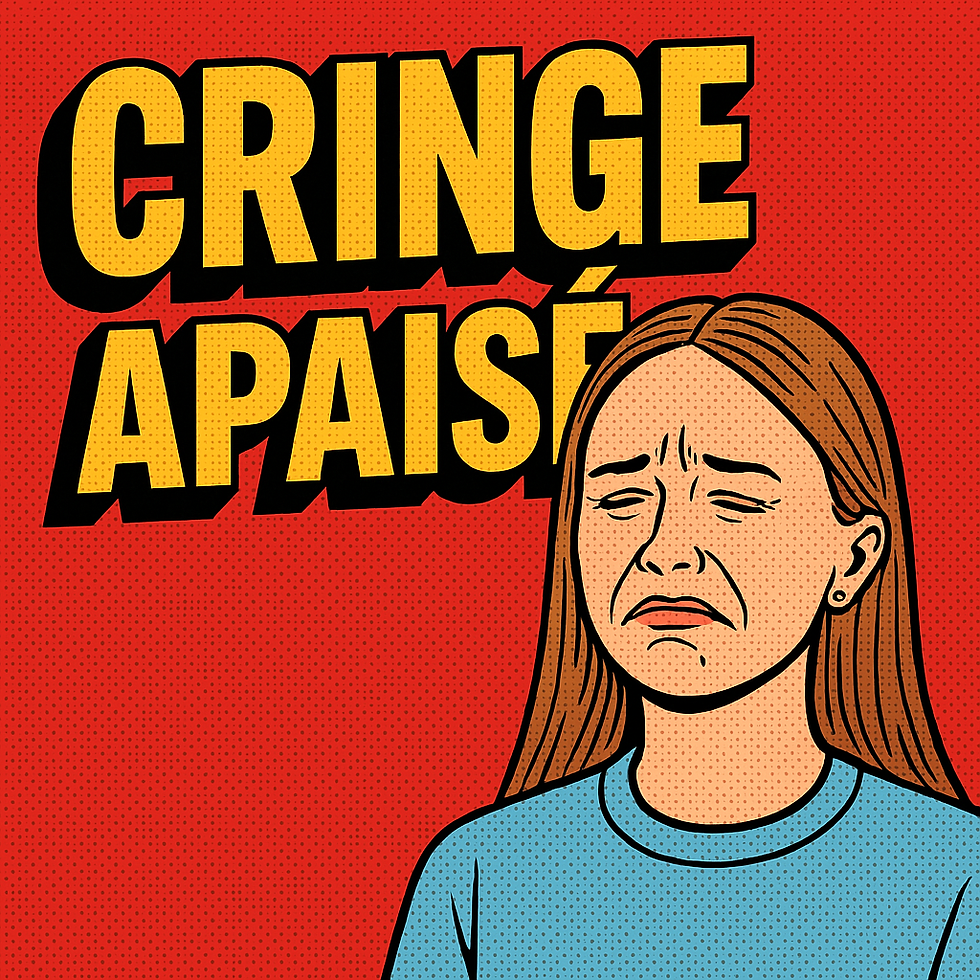
Elle hésite une seconde avant de publier. C’est une photo d’elle devant un bol de chips, une tranche de Babybel posée au bord comme une blague. Elle écrit : “girl dinner lol” avec un emoji qui pleure de rire. Et puis elle ajoute : “c’est ironique hein”. Parce qu’il faut. Parce qu’on ne peut plus poster un truc sincèrement sans se couvrir avec une blague. Il faut désamorcer. Toujours. Avant même d’aimer quelque chose, il faut déjà s’en excuser.
On est devenu experts du détachement. Tout est “un peu pour rire”, “un peu cringe”, “un peu nul mais c’est ça qui est bien”. On adore en secret, on rit en public. On fait des playlists camp en citant Britney et Shrek, mais faut que ce soit méta. On collectionne des gifs de stars en meltdown émotionnel, tout en expliquant que “c’est pas si profond”.
Le cool a changé de camp. Il ne s’affiche plus, il se dissimule. Il joue la carte du déguisement. Il prétend qu’il ne tient à rien. Et pourtant… c’est faux. Il y a de l’amour, du vrai, du trop, du tout-cassé, tapi sous les couches de second degré.
Dans cet épisode, on parle de ça. Du moment où l’ironie est devenue réflexe. Du retour des années 2000, du Girl Dinner, du cringe marketing, des Stan accounts, et de cette étrange époque où tout est ridicule… jusqu’à ce que ce soit tendance. On parle de cette génération qui préfère désactiver ses émotions plutôt que de les risquer. Et de ce qu’il faudrait aujourd’hui pour dire, sans rire : “oui, j’aime ça.”
Le règne du second degré
Il y a une scène devenue banale sur Internet, mais qui en dit long sur l’époque. Une vidéo d’un ado qui pleure en regardant un film. Le plan est flou, il essaie de se cacher. Il sait qu’il est filmé. Et pourtant, il pleure. Et dans les commentaires, ça commence toujours pareil : “Bro is in his feelings”, “Cringe but relatable”, “Mood”. Un peu d’empathie, beaucoup d’ironie. L’émotion n’est jamais laissée intacte. Elle est traduite, détournée, retournée contre elle-même pour devenir une punchline. On n’a pas arrêté d’avoir des émotions. On a juste arrêté de les montrer sans protection.
Le second degré est devenu la langue maternelle d’une génération qui ne sait plus où commence la sincérité et où s’arrête la comédie. Ce n’est pas un outil. C’est un réflexe. Une carapace sociale qu’on enfile avant même de dire ce qu’on aime. On adore chanter du Hannah Montana, mais faut préciser que c’est “pour rigoler”. On rêve encore devant Titanic ou Twilight, mais il faut en parler comme si c’était du kitsch nostalgique. “Je regarde ça pour le fun, t’inquiète.” T’inquiète, surtout. Ne crois pas que c’est sérieux. Ne crois pas que ça me touche vraiment.
Ce phénomène n’est pas nouveau. Il s’ancre dans des logiques bien plus anciennes que TikTok. L’humour post-ironique est né des ruines de l’enthousiasme des années 90 et du cynisme des années 2000. Sur Tumblr déjà, on partageait des citations de The Virgin Suicides à côté de memes débiles. On associait des souffrances réelles à des esthétiques pop volontairement absurdes. C’était drôle, beau, dérangeant. Et c’était surtout une façon de parler de soi sans le dire frontalement. Le second degré est devenu, au fil du temps, le seul espace émotionnel safe.
Puis sont venus Twitter, TikTok, Instagram, et la performativité permanente. L’ère de la story. Du tweet qui fait 80 000 likes parce qu’il résume ton trauma en trois mots et un emoji. Le contenu personnel a dû devenir divertissant pour exister. Alors on a appris à se moquer de nous-mêmes avant que les autres ne le fassent. À poster nos erreurs avec un filtre marrant. À parler de nos anxiétés en format mème. “J’ai envie de disparaître lol”, “j’vais encore me faire ghoster ptdr”. L’humour est devenu un gilet pare-balles.
Mais le prix à payer, c’est une sincérité de plus en plus fragile. On s’est mis à vivre dans le flou. À confondre vulnérabilité et storytelling. À ne plus savoir si ce qu’on dit est vrai, ou juste socialement validé. Aimer une chose “pour de vrai”, aujourd’hui, ça demande presque du courage. Parce que le regard collectif est devenu redoutable. Il analyse, moque, recycle. Il te classe. Et le mot préféré de ce regard, c’est “cringe”.
Ce mot, “cringe”, il a muté. À l’origine, il désignait une réaction physique, un malaise devant quelque chose de trop gênant, de trop intense, de trop… hors cadre. Aujourd’hui, il désigne tout ce qui ose être sincère sans recul. Tout ce qui ne s’excuse pas. Une fan qui pleure à un concert : cringe. Un mec qui avoue aimer Coldplay : cringe. Une ado qui poste une vidéo d’elle en train de chanter : cringe. La normalité est devenue gênante. Et tout le monde a peur de finir en capture d’écran dans un thread moqueur.
Mais ce rejet de la sincérité n’est pas qu’un jeu culturel. C’est une forme de défense émotionnelle collective. Une réaction à un monde saturé, instable, ironique jusqu’à l’épuisement. On vit dans une époque où les discours changent en permanence, où les repères se floutent, où l’identité est scrutée en boucle. Alors on apprend à ne plus rien dire frontalement. À coder nos émotions. À envelopper nos sentiments dans des couches de filtres, de lol, de glitch et de fausse légèreté.
Et c’est encore plus vrai dans les espaces “cool”. Les cercles artistiques, les sphères numériques, les espaces queer ou féminins où le style est un manifeste. Là où, autrefois, l’excès était un acte politique, il devient aujourd’hui un jeu d’équilibre constant. Trop de passion, et tu deviens suspect. Trop de vulnérabilité, et tu casses l’ambiance. La norme, c’est de ne pas trop y croire. De garder une distance. De jouer, mais sans se brûler.
Et pourtant, on sent bien que ça craque. Que ce second degré permanent nous épuise. Qu’il empêche la joie pleine, la tristesse franche, le rire sans gêne. Qu’il crée des personnalités en décalage constant, comme si on devait performer une version glitchée de nous-mêmes. Des gens qui aiment… à condition de ne pas le dire. Qui ressentent… mais le postent en meme.
Alors on en revient à cette question : est-ce qu’on sait encore aimer, sans filtre ? Est-ce qu’on sait encore pleurer, danser, vibrer, sans se mettre en garde contre nous-mêmes ? Ou est-ce qu’on a désappris à être sincère, simplement parce que ça ne passe plus dans le feed ?
Le cringe comme esthétique dominante
À force de tout tourner en dérision, le ridicule a fini par devenir désirable. Le cringe n’est plus une anomalie à éviter : c’est devenu un style. Une position. Une stratégie d’exposition.
Ce n’est pas un hasard si le retour des années 2000 n’a pas ramené les années 2000 telles qu’elles étaient vécues, mais telles qu’on les imagine à travers un filtre VHS saturé. Ce n’est pas la réalité qui revient : c’est le fantasme mal vieilli, volontairement mal assumé. Le gloss collant, les bagues papillon, les jeans taille basse inconfortables. Des choses qu’on aurait critiquées violemment en 2010, et qu’on adore aujourd’hui… parce qu’on les présente comme “hilarantes”.
Et au centre de ce retournement culturel : le camp. Popularisé par Susan Sontag dans les années 60, puis détourné par la pop culture queer et post-Internet, le camp célèbre ce qui est trop. Trop kitsch, trop dramatique, trop artificiel pour être pris au sérieux. C’est Cher en robe à plumes. C’est Lady Gaga en robe viande. C’est la vibe “je sais que c’est moche, et c’est pour ça que c’est génial”. Le camp est devenu le sas de décompression entre la culture mainstream et l’absurde assumé. Il permet d’aimer en riant, de consommer sans adhérer, de performer sans se compromettre.
Et c’est exactement cette posture qu’on retrouve dans la vibe Girl Dinner. Une tranche de Babybel, trois cornichons et du Coca zéro posés sur une assiette à dessert ? Ce n’est plus un non-repas, c’est un statement. Un esthétisme de la fatigue, du laisser-aller, du décrochage volontaire. Le tout, posté avec une auto-ironie douce, un filtre chaud et un sous-texte silencieux : “je sais que c’est nul, mais c’est moi.” Ce qui était perçu comme honteux devient un symbole de relâchement culturel — une manière de dire : je ne suis pas parfaite, et c’est cool.
Le cringe est devenu une armure. Et cette armure plaît. Elle plaît tellement qu’elle est récupérée par ceux-là mêmes qui se moquaient de tout ça hier. Les marques, bien sûr. Parce que là où il y a une posture, il y a un marché.
C’est ainsi qu’est né le cringe marketing. Une campagne qui joue sur le malaise, sur l’auto-dérision, sur le côté ringard assumé pour créer de la proximité. Des entreprises qui se font passer pour des ados désabusés sur TikTok. Des pubs qui surfent sur les tendances “cheugy”. Des slogans volontairement laids, des jingles volontairement pénibles. L’objectif ? Créer du lien par l’humour méta. “On sait que c’est naze. Mais on sait que vous savez. Donc on est cool.” C’est un pacte implicite entre la marque et le consommateur. Une stratégie de connivence par le bas.
Mais cette banalisation du cringe soulève une question de fond : quand tout est potentiellement ridicule, qu’est-ce qui reste pour exprimer quelque chose de sincère ? Si tout ce qu’on montre doit être contrebalancé par une blague, si chaque geste est pré-commenté par l’ironie, alors qu’est-ce qu’on transmet réellement ?
Le problème, c’est que le cringe est un langage à double tranchant. Il protège, mais il isole. Il amuse, mais il désensibilise. Il rend tout acceptable, et donc… rien de marquant. C’est une esthétique qui neutralise au lieu de révéler. Une esthétique de la fuite émotionnelle. Et ça, l’algorithme adore. Parce que ça fait du contenu fluide, partageable, viral — mais pas trop subversif. Pas trop engagé. Pas trop sincère.
Et le plus paradoxal, c’est que cette mise en scène du ridicule — volontaire ou pas — devient à son tour cool. Les vidéos virales d’ados qui dansent mal, les TikToks de boomers qui chantent faux, les photos volontairement “ugly hot”… tout devient matière à tendresse algorithmique. On like, on commente “iconic”, on rit, on partage. Mais on reste dans une zone de sécurité émotionnelle. On réhabilite le moche sans vraiment l’aimer. On célèbre le raté, mais à condition qu’il soit mis en scène, qu’il soit codé, stylisé.
Parce que le vrai cringe, le pur, le sincère, celui qui n’a pas conscience de lui-même — celui-là, on le moque encore. On le clippe. On l’expose. Il dérange. Il ne rentre pas dans le moule. Il n’a pas compris qu’il fallait ajouter une légende drôle, un filtre rétro, une musique de fond pour rendre son moment acceptable. Et c’est là que se joue la fracture.
Le cringe accepté est toujours un cringe maîtrisé. C’est une mise en scène de l’authenticité, pas de l’authenticité brute. Une version digérée, esthétisée, validée. Et plus encore : une version vendable. Le cringe est devenu une valeur marchande, une image de marque potentielle, un levier d’identification rapide. C’est le “je suis comme vous” 2.0, mis à jour pour une génération qui ne croit plus à la perfection.
Mais dans tout ça… où est la place du vrai, du fragile, du non monétisable ? Est-ce qu’on peut encore vivre quelque chose sans que ça devienne un contenu ? Est-ce qu’on peut encore être nul, maladroit, intense, ringard — sans que ce soit une stratégie ?
Parce que tant que le cringe restera un outil, une posture, une esthétique… il ne pourra jamais redevenir un état. Il restera une version emballée du chaos. Et ce chaos, on en a besoin. Pour créer. Pour aimer. Pour ressentir sans médiation.
Et peut-être que le jour où on arrêtera de tout présenter comme une blague — le jour où on acceptera que certaines choses ne font pas rire, qu’elles sont juste là, bancales et belles — alors, peut-être, on recommencera à dire quelque chose de vrai.
Fatigue émotionnelle et second degré permanent
À force de tout filtrer par l’ironie, on a fini par désactiver une partie de nous-mêmes. Pas complètement. Pas brutalement. Mais de façon diffuse, constante, insidieuse. Comme un bruit de fond qui empêche l’émotion de vraiment se poser.
Pendant longtemps, on a cru que le second degré était une forme d’intelligence. Une lucidité. Un bouclier contre la mièvrerie, le pathos, l’excès. Et c’était parfois vrai. L’humour, surtout dans les cultures marginalisées ou précaires, a toujours servi de stratégie de survie. Rire de soi, détourner, exagérer : c’est une manière de rester maître de son récit. Mais quand cette posture devient une norme, une obligation, une habitude culturelle ancrée, elle finit par anesthésier ce qu’elle prétend protéger.
Regarde les Stan accounts. Au départ, c’était des comptes de fans dévoués, bruyants, excessifs, profondément sincères. Des ados qui aimaient fort, qui criaient “MOTHER IS MOTHERING” sous chaque photo, qui faisaient des edits à la limite du culte. Et puis, peu à peu, la moquerie est arrivée. On a commencé à rire des Stan trop émotifs, trop intenses, trop sérieux. On les a tournés en dérision, même quand ils étaient touchants. Résultat : aujourd’hui, même les fans doivent performer une forme de détachement. Ils “stan” ironiquement. Ils tweetent des déclarations d’amour avec 14 couches de mèmes et des emojis en overdose. Ils aiment, mais il ne faut pas que ça se voie trop.
Cette fatigue émotionnelle, elle ne touche pas que les fandoms. Elle est partout. Elle s’infiltre dans nos relations, nos goûts, nos publications, nos réactions. Elle crée un paradoxe permanent : on veut se connecter, mais on a peur d’être pris au sérieux. On veut exprimer des choses, mais il faut que ce soit drôle, rapide, décodable. Le drame, c’est qu’on ressent encore. Mais on ne sait plus comment le dire sans performer.
On se moque des gens trop premier degré comme si c’étaient des extraterrestres. Quelqu’un qui poste un texte trop honnête sur sa rupture ? Cringe. Quelqu’un qui filme un moment heureux sans filtre, sans musique, sans montage ? Inconfortable. Quelqu’un qui ose dire qu’il est triste sans l’habiller de sarcasme ? Malaise. Parce que la sincérité, aujourd’hui, fait peur. Elle fait perdre le contrôle. Elle implique une vulnérabilité réelle, pas médiatisée. Elle ne peut pas être “rattrapée” par un commentaire ironique.
Et ce que ça produit, ce n’est pas juste un repli esthétique. C’est un appauvrissement de l’expérience émotionnelle elle-même. On finit par ne plus savoir ce qu’on ressent vraiment. À force d’exprimer la joie en mode “LOLLLL” et la peine avec des gifs de chats qui pleurent, on perd la densité. On perd la texture. On ne traverse plus les émotions, on les stylise. Elles deviennent des objets à montrer, à décorer, à rentabiliser.
Cette dynamique touche surtout les générations les plus exposées : les ados et jeunes adultes qui ont grandi dans une narration permanente. À peine un événement est-il vécu qu’il est transformé en contenu. Tout doit être documenté, optimisé, rendu “consommable”. Ce que tu vis ne compte pas vraiment tant que tu ne l’as pas bien dit, bien filmé, bien monté. Et dans ce processus, l’émotion brute devient gênante. Elle déborde du cadre. Elle ralentit la cadence. Elle perturbe le scroll.
Il y a une forme de cynisme diffus qui s’installe. Pas le grand cynisme noir et assumé. Un cynisme doux, passif, presque triste. Une manière de ne plus croire tout à fait en rien. Pas par choix, mais par usure. Le monde est trop rapide, trop dense, trop instable. Alors on se protège. On relativise. On dit “j’adore ce film mais je sais qu’il est nul”. “J’aime cette chanson mais c’est un guilty pleasure”. “Je suis accro à ce drama mais t’inquiète, c’est du hate-watch.” On met des gilets pare-balles à nos plaisirs. On se dédouane. Comme si aimer sans ironie, c’était un risque réputationnel.
Et pourtant, dans les interstices, on sent que quelque chose résiste. On voit ces vidéos d’ados qui chantent faux mais qui y mettent tout leur cœur. Ces posts maladroits mais sincères. Ces moments où quelqu’un ose dire “je trouve ça beau” sans rajouter “enfin, je sais pas, c’est peut-être bête”. Et quand ça arrive, c’est comme une bouffée d’air. Parce que ça sonne vrai. Parce que ça nous rappelle ce qu’on a perdu.
Alors, la vraie question, c’est peut-être pas “est-ce qu’on peut encore être sincère ?”, mais plutôt : est-ce qu’on ose encore le devenir ? Parce que ça implique d’être vulnérable. D’être moqué. D’être mal lu. D’être vu, vraiment. Et c’est ça, le vertige. Pas d’aimer. Pas de ressentir. Mais d’oser le faire sans filtre.
Dans un monde où tout est commentaire, la sincérité devient un acte de résistance. Elle est plus inconfortable que le cringe, plus dangereuse que la moquerie, plus instable que la stratégie. Elle n’a pas de plan B. Elle ne s’explique pas. Elle ne se monétise pas. Elle se vit, c’est tout.
Et c’est peut-être ça, la fatigue qu’on traîne. Pas celle de devoir tout commenter. Mais celle de ne jamais pouvoir juste… être.
CONCLUSION — Le retour du courage émotionnel
On vit une époque où le cool ne veut plus dire grand-chose. Où l’esthétique remplace la sensation. Où l’émotion est permise à condition qu’elle soit déguisée. Et pourtant, quelque part au milieu de tout ce bruit, on sent une faille.
Parce qu’on est nombreux à en avoir marre de devoir rire de tout ce qu’on aime. Marre de devoir coller un “lol” ou un gif sarcastique à chaque chose qui nous touche. Marre de ne plus savoir si on adore un truc… ou si on s’est juste habitué à le performer.
Le vrai risque aujourd’hui, ce n’est plus d’avoir mauvais goût. C’est d’avoir un goût sincère.
Alors non, cet épisode ne va pas te donner la recette miracle pour désapprendre l’ironie. Mais il pose une question simple : et si aimer pleinement, maladroitement, excessivement… c’était ça, la vraie radicalité contemporaine ? Et si la prochaine révolution culturelle, ce n’était pas de consommer différemment, mais de ressentir autrement ? Sans stratégie. Sans packaging. Sans légende.
Si cet épisode t’a remué, si t’as senti une résonance quelque part entre deux références à des Babybel ou des gifs d’ado qui pleurent… t’es pas seul·e. Et surtout : t’es à ta place ici. Cappuccino & Croissant continue de faire ce que les autres formats évitent. Parler de pop culture, oui. Mais parler de ce qu’elle fait à nos corps, à nos affects, à nos rêves.
Et si tu veux soutenir cette démarche – une approche indépendante, libre, parfois inconfortable mais toujours honnête – tu peux rejoindre le Patreon du podcast. Ça me permet de garder la voix libre, de continuer à creuser les sujets jusqu’à l’os, et d’oser dire les choses qu’on ne dit pas dans les briefs sponsorisés. Tu y trouveras aussi du contenu exclusif : des lectures de mes livres, mes réflexions en coulisses, les épisodes en avant-première, et l’accès à tout ce que je construis en parallèle – albums, romans, lives radio à venir.
D’ailleurs, si tu as aimé cet épisode, je t’invite à écouter mes deux derniers EPs, En construction et Underconstruction. Deux projets musicaux pensés comme des extensions émotionnelles de ce podcast. Deux glitchs sonores dans une époque trop lisse. Ils sont disponibles sur toutes les plateformes d’écoute.
Et si tu ne sais pas par où commencer… commence par là où ça dérange. Là où ça pique un peu. C’est souvent le signe que quelque chose de vrai est en train de se dire.





Commentaires